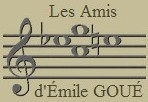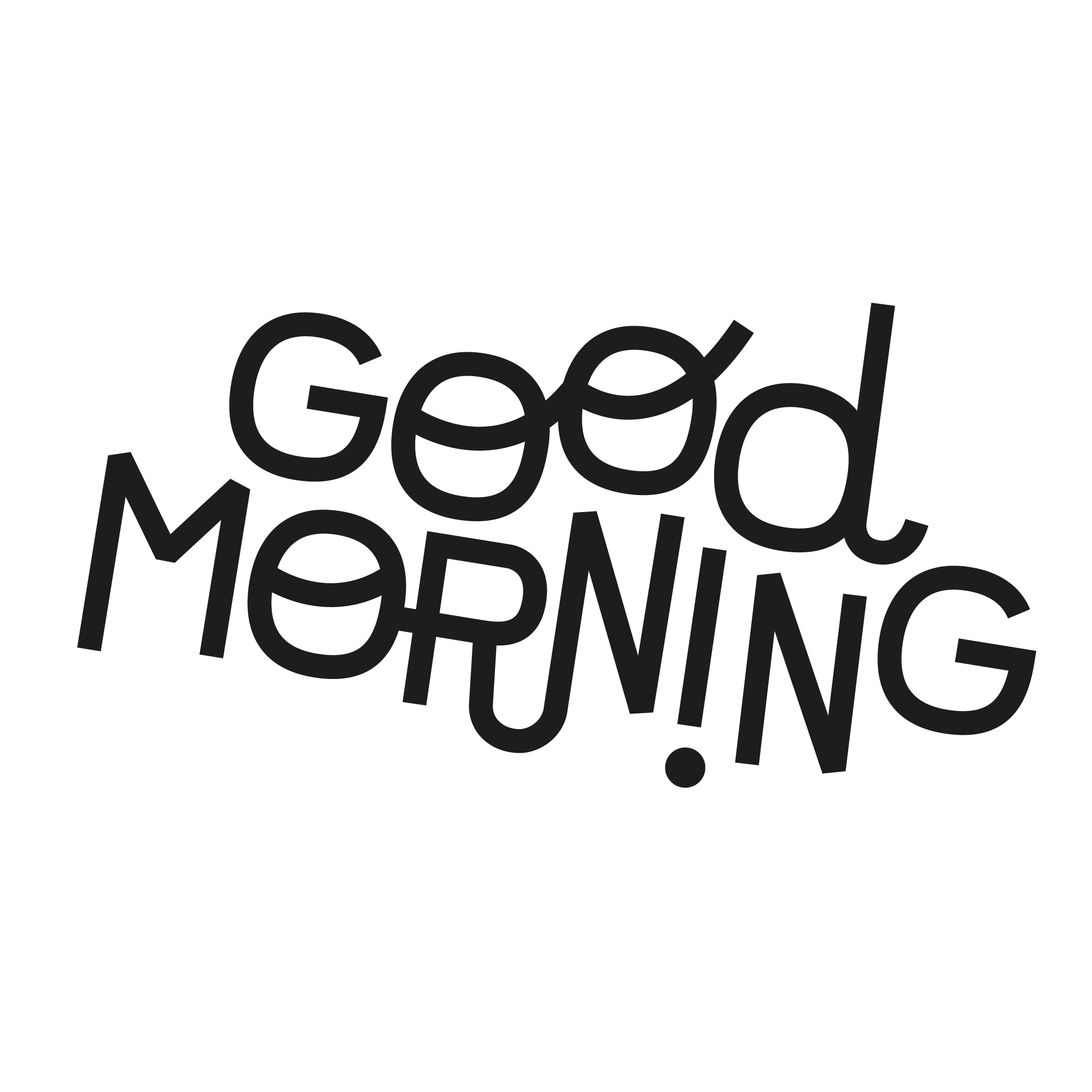Identifier une rhizarthrose de manière fiable repose sur une combinaison d’écoute des symptômes, d’examen clinique et d’imagerie médicale.
Un diagnostic précis permet de comprendre l’origine des douleurs à la base du pouce et d’orienter vers une prise en charge adaptée, dès les premiers stades de la maladie.
Cette étape fait pleinement partie du parcours pour comprendre la rhizarthrose, depuis les premiers signes jusqu’à son évolution.

Quand faut-il envisager un diagnostic ?
Certaines douleurs au pouce peuvent être passagères, liées à un faux mouvement ou à un surmenage articulaire. Mais quand l’inconfort devient récurrent, qu’il gêne les gestes du quotidien – ouvrir un bocal, tourner une clé, porter un objet – ou qu’on observe une perte de force ou une légère déformation, il est important de consulter.
Des signes précoces doivent alerter :
Ces éléments peuvent indiquer une rhizarthrose débutante, même si la douleur reste modérée. Plus le diagnostic est posé tôt, plus les options de prise en charge conservatrice sont efficaces. À ce stade, des gestes simples peuvent déjà être envisagés pour limiter l’évolution de la maladie.
L’examen clinique, point de départ essentiel
La première étape du diagnostic repose sur un examen clinique minutieux réalisé par un médecin généraliste, un rhumatologue ou un chirurgien de la main.
L’interrogatoire permet de préciser :
L’examen physique évalue :
Des tests spécifiques peuvent être réalisés, comme le test de Grind, qui consiste à exercer une pression et une rotation sur l’articulation du pouce pour reproduire la douleur typique de la rhizarthrose.

Le rôle de l’imagerie médicale
Une radiographie standard du pouce est l’examen de référence pour confirmer la rhizarthrose. Elle permet de visualiser :
La classification de Dell utilisée par les professionnels de santé, permet de décrire les stades de sévérité sur les clichés radiologiques, du stade I (forme débutante) au stade IV (atteinte avancée avec déformation). Cette évaluation est précieuse pour envisager des options de traitement adaptées à chaque stade, notamment chirurgicaux.